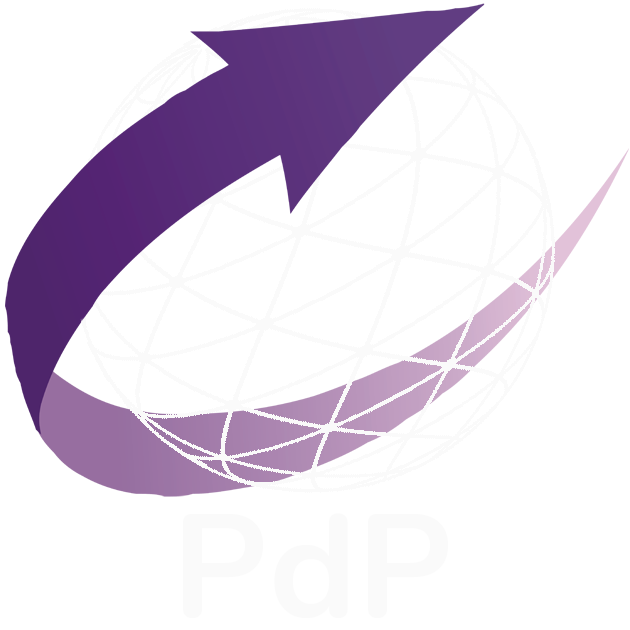LE DOSSIER

SÉCURITÉ & INSÉCURITÉ
INSÉCURITÉ
Définition du Larousse :
- Absence de sécurité. État d'un lieu qui n'est pas sûr, soumis à la délinquance ou à la criminalité.
- Sentiment de vivre dans un environnement physique ou social favorisant les atteintes aux personnes et aux biens. Perception d'une situation menaçante d'où l'inquiétude.
Article 2 : Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.
Article 17 : La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
La revendication de sécurité est souvent au cœur de débats de nature sociale et politique. De l'insécurité des individus on passe à celle de la cité, jusqu'à celle d'ordre international. État d'alerte et d'inquiétude de la société face au risque, l'insécurité correspond à un sentiment anxiogène qu'il peut être tentant d'instrumentaliser politiquement mais qui peut conduire à des comportements irrationnels de tout ou partie d'une société.
Aussi la question de la lutte contre la violence et l'insécurité occupe-t-elle depuis quelques années une place importante dans le débat politique français. C'est un débat qui mobilise l'opinion et suscite bien des prises de position politiques.
L'insécurité n'est pas un phénomène nouveau. Pour s'en convaincre, il est bon de relire l'ouvrage de l'historien Jean Delumeau, La Peur en Occident (1978), qui s'ouvre sur l'émerveillement de Montaigne qui visite la ville d'Augsbourg en 1580. Montaigne note combien il est difficile pour un étranger d'entrer dans la ville après le coucher de soleil. Précautions singulièrement révélatrices d'un climat d'insécurité : « quatre grosses portes successives gardées, un pont sur un fossé, un pont-levis et une barrière de fer ne paraissent pas de trop pour protéger contre toute surprise la ville la plus peuplée et la plus riche d'Allemagne. Dans un pays en proie aux querelles religieuses et tandis que le Turc rôde aux frontières, tout étranger est suspect surtout la nuit. Sans compter le danger que font courir, les gens de peu et autres brigands ».
L'insécurité a toujours existé. « L’insécurité est à la mode, c’est un fait ». Cette phrase, ouvrant un article de presse, n’a pas été écrite dans un quotidien des années 2010 mais en 1907, nous rappelle le sociologue Laurent Mucchielli. Ce n'est pas un phénomène nouveau mais depuis le XVIIème siècle, la violence est moins valorisée. Les normes sociales encouragent la tempérance. Dans ce lent processus de civilisation, on assiste à la pacification des relations sociales qu'a analysée le sociologue Norbert Elias dans son célèbre ouvrage La Civilisation des mœurs (1939). Le recul spectaculaire des violences dans les sociétés occidentales est un fait avéré par les historiens. Notre sensibilité à l'égard de la violence se recompose. Notre société, très policée, accorde une moindre tolérance à la violence. Ainsi, quand un phénomène social tend à disparaitre (les homicides), son résidu quoiqu'infime est perçu comme inacceptable. Cela entraîne une extrême sensibilité à l'égard de ce qui en persiste.
En France, la violence et le crime ont été domestiqués, civilisés. En l'espace de quatre siècles on est passé de 150 homicides pour 100 000 habitants à 1,2 homicide pour 100 000 habitants. Cependant depuis une vingtaine d'années, et c'est ce qui est préoccupant, on assiste à une reprise de cette violence physique. Ainsi, selon le criminologue Alain Bauer, 2023 aurait été la pire année depuis 50 ans, pour les homicides, les tentatives d'homicide et les coups et blessures ayant entraîné la mort. De nombreux indicateurs sont passés au rouge. Par ailleurs, il ne faut surtout pas minorer la violence endémique qui gangrène le milieu scolaire. Cependant, on constaterait une légère diminution des atteintes aux biens matériels tandis qu'augmente la délinquance informatique (arnaques en tous genres). Les infractions liées à la drogue sont en augmentation. Les règlements de comptes entre délinquants et criminels sont aussi en nette augmentation. Selon de nombreux psychologues, plutôt que d'avoir recours à la parole pour régler les conflits, trop souvent l'on a recours à la violence. La violence serait alors perçue comme un élément de régulation qui pourrait remplacer la loi.
LE SENTIMENT D'INSÉCURITÉ
Dans les années 70-80, la majorité des intellectuels et des journalistes de gauche, dans leur vision marxisante du monde social, considéraient que l'augmentation de l'insécurité était un fantasme utilisé par le pouvoir pour mieux réprimer toutes les velléités de révolte légitime de la jeunesse et de la classe ouvrière. Aujourd'hui, la plupart des commentateurs semblent admettre que la société française est de plus en plus menacée par une violence dont on ne perçoit pas toujours la signification.
La gauche a eu et a encore pour certains des plus optimistes, tendance à privilégier le positionnement social sur la réalité des faits. Le crime serait aux yeux de ces défenseurs de l'auteur de faits antisociaux, la conséquence de la violence sociale. Bénéficiant de la culture de l'excuse, l'accusé est alors perçu et présenté comme victime d'un système économique, colonial, capitaliste... L'accusé, auréolé d'une forme de virginité est alors présenté comme le héros inscrit dans une résistance à toute forme d'oppression. Il est un rebelle qui défie une autorité jugée illégitime. Certains auteurs, tels Michel Foucault, qui en a retiré une notoriété internationale, ont accrédité cette image du délinquant à la fois victime malheureuse et héros courageux d'une société oppressive dont il ne fait que souligner les contradictions.
UN CHANGEMENT RADICAL
On peut quantifier et qualifier la violence et la délinquance mais on est incapable de mesurer l'insécurité car on se place au niveau du ressenti. Ce qui relève de la subjectivité, du ressenti, du sentiment.
Au Colloque de Villepinte 1997, « Des villes sûres pour des citoyens libres », on assiste à un tournant du parti socialiste.
Le ministre de l'Intérieur Jean-Pierre Chevènement déclare : « Mesdames, Messieurs, il y a aujourd'hui deux menaces auxquelles la République doit faire face : le chômage et l'insécurité ». Avec l'insécurité, le socle des valeurs républicaines est ébranlé.
Dans la foulée, le Premier ministre de l'époque, Lionel Jospin, précisera que la politique de sécurité doit faire prévaloir « la responsabilité individuelle » sur les « excuses sociologiques ». Autrement dit, ni la pauvreté ni le chômage ne doivent être désormais vus comme des circonstances atténuantes pour la délinquance.
Le sentiment d'insécurité est nourri par l'identification à la ou aux victimes d'un larcin, d'un cambriolage, de coups et blessures, de viol, de violence... Désormais, on le reconnaît, le climat anxiogène est basé sur des faits. Les incivilités sont en lien direct avec la peur ressentie. L'environnement dégradé est perçu comme non sûr. Au-delà du partage de l'émotion quand un fait-divers particulièrement tragique remue la société et les responsables politiques, les Français souhaitent et réclament plus de fermeté de la part de l'État et exigent plus de sécurité. En 2020, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin affirme : « La France est malade de son insécurité ».
Les peurs se cristallisent dans les propos de certains politiciens qui n'hésitent pas à employer des mots lourds de sens, souvent excessifs, parfois caricaturaux : le terme de décivilisation fait son apparition, combiné parfois avec d'autres plus anciens comme celui d'ensauvagement, voire de barbarie.
À l'opposé, le sociologue Laurent Mucchielli se démarque des discours sécuritaires qu'il juge alarmistes, voire démagogiques. Ce faisant, il ravive les clichés médiatiques sur les banlieues, ghettos et quartiers de relégation.
Inscrits dans une atmosphère incertaine, les Français sont voués au questionnement, au doute et à la remise en cause d'une certaine bienveillance qui prévalait à l'égard des faits de délinquance.
UN CLIMAT ANXIOGENE
Aux divers types de criminalité : vols, viols, agressions, cambriolages... auxquels la France est confrontée, s'ajoute le terrorisme islamique qui a spectaculairement engendré un profond sentiment d'insécurité. Les attaques terroristes qui ont fait de nombreuses victimes ont profondément traumatisé la population française, désormais consciente de sa vulnérabilité. Ce qui a suscité de légitimes inquiétudes en matière de sécurité publique. La lutte contre le terrorisme devenait un des problèmes majeurs auxquels l'État était confronté.
L'insécurité en France est un sujet complexe et sensible. Les autorités travaillent sans relâche à renforcer les mesures de sécurité et à prévenir la criminalité, tout en respectant les droits fondamentaux des citoyens. Il faut notamment comprendre comment et pourquoi les crimes et délits imputés à la délinquance juvénile sont en nette augmentation depuis quelques années. Les jeunes impliqués dans des comportements à risque ou impliqués dans des actes délictueux parfois d'une gravité extrême semblent désormais plus nombreux si l'on se réfère aux données fournies par le Ministère de l'Intérieur : vols, viols, menaces en réunion, absence d'assurance dans la conduite d'un véhicule à moteur, refus d'obtempérer à une injonction de la police de la route, coups et blessures... Le sont-ils réellement ? C'est possible, mais chiffres reposent sur des indicateurs assez mouvants, si bien que les certitudes sont parfois sujettes à caution, d'autant que l'intérêt médiatique entraîne un effet de loupe qui tend à grossir les événements.
Quoi qu'il en soit, la nécessité d'une réponse pénale immédiate et ferme serait le plus sûr moyen de protéger non seulement la société mais aussi de protéger le jeune délinquant face à une ou plusieurs tentations de récidive.
Pour RAPPEL
« La vertu de l'État, c'est la sécurité »
Dans son Traité politique (1667) Spinoza affirme que le but de l'État est de garantir la liberté des citoyens. Il insiste ensuite sur la sécurité : « La vertu nécessaire à l'État est la sécurité. »
Pour Spinoza, il est indispensable de préserver le corps pour permettre à l’esprit de penser. C'est pourquoi il faut que le corps soit déchargé de tout danger.
L'État, seul instrument de légitimité, est garant de la sécurité des citoyens. La régulation du crime lui incombe. La sûreté est une composante de la liberté. Il faut encore et toujours rappeler que c'est la Loi qui libère. Depuis les temps les plus reculés de l'humanité vivant en société, la sécurité est du ressort de l'État.
Si la sécurité est un ferment de la cohésion sociale, alors les autorités doivent réagir pour éviter que les citoyens ne se tournent vers les discours extrêmes.
LA LEÇON DES J.O DE PARIS
Avec l'engagement des forces de l'ordre dans le cadre des Jeux Olympiques à Paris, les citoyens se sont sentis en sécurité dans les rues, à la terrasse des cafés, dans les stades... Ce fort déploiement des forces de police a assuré la paix civile. On a pu constater une baisse significative des actes de délinquance. Ainsi lutter contre l'insécurité est possible.
Ce qui est fondamental, essentiel pour un être et par extension pour une famille, un clan, l'est tout autant à une plus grande échelle, pour un peuple, une société, une nation : la sécurité. Les Français exigent plus de sécurité. C'est un droit légitime que revendiquent tous les citoyens.
CONCLUSION
Non, invoquer la crainte de l'insécurité ne relève pas du tout de l'exagération. C'est une appréhension logique et légitime. En effet, il est tout à fait légitime d'évoquer le sujet parce que rien n'est plus précieux que la vie. Il n'en reste pas moins que l'insécurité est le fond de commerce de certains groupes politiques. Les réseaux sociaux sont des caisses de résonance qui jouent sur l'instrumentalisation de la peur, ce qui contribue à l'instauration d'un climat anxiogène.
La sécurité est un enjeu politique majeur. C'est un thème sérieux qui ne relève pas exclusivement des compétences de tel ou tel parti politique. Il est un devoir pour les gouvernants. Un droit pour le citoyen, un devoir pour les responsables gouvernementaux. Par ailleurs, on insistera sur la fonction dissuasive de la police qui doit être plus présente dans la cité et sur le rôle important de la réponse judiciaire.
Jacky Guedj
Enseignant retraité, écrivain
Membre fondateur du cercle de réflexion Progressistes du Possible